FAJR
Fajr [1]
Comporter : du latin cum-portere,
porter avec. Passif en son mode actif, actif en son mode pronominal : un
verbe donc assez ambigu pour attirer les assoiffés de sens… L’Un s’y révèle
multiple, sinon Autre ; l’invisible, image ; l’apparence, vide ;
le non-dit, cri… En tout cas, le passage à la limite – à l’instar du
jaillissement soudain de l’eau hors de sa source – nous ramène inlassablement à
l’évidence du premier ballet, chromosomique, de notre existence – ex-stare, se
tenir hors de… – où 1+1 ne cesse jamais d’être égal à un [2],
imperturbable argument immobile au centre de la roue.
La construction suivante d’une
des plus célèbres figures du monde druidique – le triskel – donne à ce
bouleversant paradoxe un éclairage tout-à-la-fois très localisé et ouvert à des
interprétations universalisantes. Nombre
de lieux remarqués, en diverses régions d’Europe occidentale, particulièrement
en Bretagne, Irlande et Pays de Galles, groupent ainsi par trois – pierre
levée, fontaine et arbre séculaire, souvent – des repères significatifs d’une
sacralité immémorialement honorée. Mais le propos nourrit de plus subtiles
considérations…
(Chaque point marque le centre d’un cercle ou d’un arc
de cercle nécessaire au tracé de la figure)
Ce que raconte en particulier ce
dessin, c’est que nos aïeux cultivaient un savoir réunissant notamment les
sciences empiriques de la Nature et celles plus abstraites des nombres et de la
géométrie. La série : 0 + 1 = 1 ; 1 + 1 = 2 ;
2 + 1 = 3 ; 3 + 2 = 5 ; 5 + 3 = 8 ;
etc., reconnue aujourd’hui sous le nom de « suite de Fibonacci »
et qui permet d’assembler les trois spirales du triskel ; met en effet en
jeu la « Divine Proportion [7] »
C’est à ce comportement que
chaque aube nous invite. Mais il ne s’agit pas de retisser seulement le lien
entre ici et là. Il y a urgence à rétablir celui entre le local et le global,
en ne pensant le second qu’à partir des réalités du premier, avant de limiter
les actions sur celui-ci à partir des recommandations de celui-là ; les
unes et les autres sans cesse affinées par l’entretien constant de leur dialogue.
Ainsi en va-t-il de l’équilibre du monde, à l’instar de la quête sans fin de la
Divine Proportion : c’est d’être d’abord inconnu – fondamentalement
inconnaissable ? – que chaque lieu devient la mesure de plus en plus
précise du Tout, Son oreille, Sa voie, Sa présence… Prenons-en soin autant qu’à la prunelle de
nos yeux : ils sont, de nature, indissociablement liés ; même
voyageant, si je suis, c’est forcément quelque part [11].
L’écueil majeur qui nous empêche de répondre à ces questions est la confusion établie entre le verbe « être » et le nom homonyme. Partant de l’idée que le premier se contente d’établir « une simple relation d'identité ou d'implication entre un sujet et un prédicat, ou mieux entre un objet (x) et telle ou telle fonction (fx) », les philosophes occidentaux modernes, notamment les Existentialistes, ont défini le second comme un mode d’être conditionné par ses capacités de conscience et de modification volontaire de son identité. Mais aussi séduisante peut paraître cette vision – notamment dans son appréhension de la liberté humaine – elle n’en confine pas moins celle-ci à l’intérieur de ses contraintes naturelles, même si l’Être-là – le fameux « Dasein » de Heidegger – reste hypothétiquement capable de devenir le Là, c’est-à-dire atteindre à la conscience pleine et totale du lieu où il se tient.
Abandonnant ainsi l’enveloppe de l’ego qui fonde son existence (ce qui donne conscience de se tenir hors-de [13]) ? C’est à cet état auquel aspire tout soufi et autre chercheur védantiste, bouddhiste, taoïste ou autre. Un éveil spirituel décisif où se révèlerait, assurent ceux qui prétendent l’avoir vécu, le sens absolu de l’Être. Aucun chemin – ascèse, prière voire produit psychédélique… – n’est cependant sûr et les accidents de parcours sont légion, notamment dans l’usage de psychotropes. L’aboutissement rêvé reste totalement soumis au tawfiq, à cette immaîtrisable concordance tantôt évoquée. Nous voilà donc revenus au point de départ de notre petit entretien ? Pas exactement, puisque nous avons entre-temps cheminé ensemble. C’est-à-dire vécu un partage, peut-être une expérience…
[1] Seuil de l’aube, en arabe.... Une situation
naturellement journalière qu’il convient d’éviter de passer au crible de
l’esthétisme, un douanier à point exigeant au passage de la moindre frontière
qu’il finit par en dénaturer le sens… On peut contacter le scribe du présent
texte par courriel à l’adresse : manstaw@gmail.com
[2] C’est aussi dire que le 2, résultat plus classique de l’addition
1+1, est en soi une unité totale…
[3] Le Yi-King, traduit par Richard Wilhem et Étienne Perrot, éditions Médicis, Paris, 1973.
[4] À l’instar de tout rapport numérique, plus généralement de toute existence, un constat qui fonde notamment le droit fondamental de celle-ci. À ceci près, cependant, qu’en langage mathématique strict, l’infini n’est pas une quantité numérique mais une limite, c’est-à-dire un concept inquantifiable.
[5] Avec notamment cette limite que, divisé par 1/n
entendu comme une approche du 0 – une vision quantitative certes mathématiquement
discutable, comme dit tantôt… – le 1 tend à l’Infini.
[6] Les musulmans attachés au dhikr – « le rappel »,
en arabe, un rituel de psalmodies répétées jusqu’à plus soif – ont ainsi cette
fréquente propension à préférer l’incantation « la
ilaha illa Huwa » (il n’y a d’adorable que Lui)
à la plus classique « la ilaha illa Allahou » (il n’y a d’adorable
que Dieu). La troisième personne du singulier – huwa, en arabe – représente
celui qui n’est ni moi ni toi : l’absent du discours, donc.
[7]
[9] De quelle science était ainsi vêtu le « Fou
guenilleux » auprès de qui les druides s’assemblaient chaque année en
forêt des Carnutes ou de Brocéliande ?
[10] Une droite orientant six cercles de rayon 8. Les uns
et les autres exactement situés par un répertoire choisi de segments reliant
diverses intersections entre ces sept éléments fondamentaux, trois quarts de
cercle de rayon 5, suivis de trois autres de 3 puis encore trois de 2 et,
enfin, trois demi-cercles de 1 complètent la figure.
[11] N’est-ce pas en déposant son ego devant Béthel – la
demeure de Dieu – que Jacob (Paix et Bénédictions sur Lui) devint Israël,
« le champion de Dieu » ? À des années-lumière, donc, de la récupération
outrancière de ce nom qu’en a faite l’entité sioniste martyrisant le peuple
palestinien…
[12] On reviendra plus loin sur l’hypothèse de cette
« réalité »…
[13] Un concept plus étroitement associé qu’on le croit à
l’expérience (Du vieux latin, perire : traverser, essayer, risquer ; et ex
: hors de), fruit d’une traversée accomplie, d’un risque assumé.
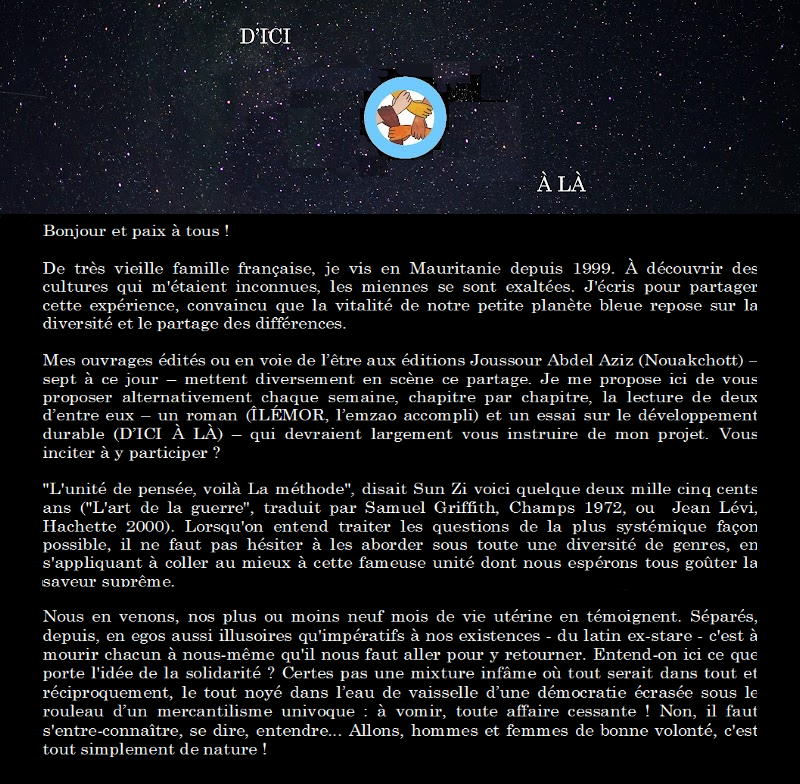


Commentaires
Enregistrer un commentaire