Juifs en Chrétienté
EXTRAITS DE MON OUVRAGE D'HISTOIRE
GENS DU LIVRE
en Eurasie occidentale, Afrique du Nord et Sahel
des premiers siècles de l'ère chrétienne à l'aube de la révolution thermodynamique
« […] La civilisation – en son sens d’organisation sociale par et pour la cité – se banalisa en terres occidentales sous l’égide des Romains. S’opposant, en son principe, à la tribalisation – organisation sociale par et pour la tribu, le clan ou la horde – elle admettait dans la pratique des adaptations flouant les droits citoyens, au profit des survivances tribales : la tyrannie, perversion de la civilisation et dégénérescence du tribalisme, en est un exemple significatif. D’un point de vue économique et sans tenir compte des importantes variations entre différents types de développement de la cité – Itil, la capitale des Khazars cavaliers des steppes, ne peut fonctionner comme Rome, la capitale des paysans latins – toute civilisation implique le développement de valeurs d’échange : le commerce lui est indispensable. La tribalisation, quant à elle, peut fonctionner et fonctionne naturellement dans la production et le troc de valeurs d’usage. Lorsqu’un groupement se spécialise dans la circulation marchande – les juifs en sont l’exemple le plus typique – il accumule des valeurs d’échange qui le poussent, en l’absence d’un système civilisé conséquent fluidifiant la circulation monétaire, à l’usure et à la spéculation : ce sera un des drames fondateurs du monde moderne. Nous y reviendrons également plus loin.
Nous concentrant sur le dernier tiers du premier millénaire de l’ère chrétienne, essayons pour l’instant de comprendre les racines du problème. Au 8ème siècle, le développement de la civilisation musulmane dynamise, nous l’avons vu et nous le reverrons dans notre troisième partie, les communautés juives entre Baghdad et Cordoue. En cet espace largement sécurisé, l’argent et l’or abondent et il est infiniment plus rentable de risquer ses bénéfices dans l’organisation de caravanes ou de razzias lointaines que de les accumuler en vue de pratiques usurières limitées, du moins légalement, au seul cercle des non-musulmans et des non-juifs. Les marchands juifs méditerranéens venant en Europe continentale – la représentation populaire les y confond avec les « Syriens » – achètent des esclaves, des fourrures, de l’ambre, des métaux, du bois. On s’adresse à des intermédiaires, parents ou rencontrés dans les synagogues disséminées le long des anciennes voies romaines et survivances de l’ancien réseau marchand juif. Le commerce de la nouvelle civilisation arabo-musulmane déborde sur une aire privée de numéraires et vient en modifier le fonctionnement.
Pour fournir leurs riches coreligionnaires payant en argent compté, les juifs d’Europe continentale troquent des valeurs d’usage, réservant à d’autres tâches la précieuse monnaie en provenance de l’aire musulmane. Elle est essentiellement destinée aux seigneurs, aux puissants, à qui l’on va prêter, à des taux faramineux (jusqu’à 85 % sur un an !) garantis par des valeurs d’usage (récoltes et, du moins un temps, propriétés foncières ; esclaves, minerais ou mines), réintroduites spéculativement dans le système ainsi bouclé. Au fur et à mesure que la monnaie, fondue et refrappée, recircule dans les sociétés occidentales, l’usure en direction des petits grandit. On gage alors ce qu’on peut : sa production à venir, bien sûr, mais aussi sa femme ou ses enfants… À partir du milieu du 10ème siècle, nous le verrons plus précisément, la pratique se généralise en Occident, confinant dangereusement la masse monétaire à des fins non-productives et entretenant de redoutables rancœurs. […] »
« La féodalité est économiquement une anti-civilisation : fréquemment confinée entre l’usurier et le seigneur, la masse monétaire quitte inexorablement le système commerçant – fondement de la civilitas – qui peine à se développer et s’oppose, en conséquence et par nécessité, à cette oppression sur les affaires, sauf, bien évidemment, dans sa variante juive qui combine les deux systèmes. Rien d’étonnant donc à ce que les premiers foyers antijuifs se soient constitués parmi les marchands. C’est à Ratisbonne – capitale du saint empire Germanique et seconde ville d’Europe de l’Ouest (quarante mille habitants, en l’an 1000), après Venise – qu’éclate le premier « pogrom » contre les juifs, à l’occasion des prêches pour la première croisade vers Jérusalem. […] »
Pour comprendre l’évolution de la situation en Europe de l’Est, il faut tout d’abord revenir un peu en arrière sur le développent du judaïsme dans cette région du monde :
« […] En ce qui concerne les Khazars, la conversion de ces turco-mongols installés de Kiev à la mer d’Aral (capitale : Itil, à l’embouchure de la Volga) surprend. On sait en effet que la religion juive était dominée, depuis la fin du premier siècle, par les Pharisiens qui avaient notamment décrété la loi de l’appartenance religieuse par transmission maternelle. Les historiographes juifs en ont déduit que la notion de « peuple élu » avait pris là une dimension raciale, exclusive. Comment interpréter alors la conversion des Khazars, six siècles plus tard ?
Trois hypothèses restent à approfondir. En un, les rabbins venus de Baghdad, dit-on, prêcher leur talmud visaient en priorité de puissants motifs économiques. Cette hypothèse doit être étudiée avec d’autant plus d’attention qu’au 8ème siècle, la Khazarie contrôle la quasi-totalité des débouchés des voies nord-orientales de commerce (Baltique-Mer Noire, Crimée-Inde, Caspienne-Chine), avec un colossal marché d’esclaves, de fourrures, d’ambre, de peaux et de soies, centré sur Kiev (dont les Vikings varègues, nous le verrons par la suite, s’empareront à partir du 10ème siècle). En deux, la loi du sang édictée par les rabbins de Yavné (Palestine) était encore loin d’être perçue comme intransigeante. Faire de la judéité maternelle une condition suffisante pour déterminer la religion de ses enfants (comme le père, en islam) n’en implique pas la nécessité, invalidant ou marginalisant les conversions au judaïsme ; encore moins, bien évidemment, le caractère indélébile de la foi.
De nombreux indices semblent indiquer que les mouvements spontanés de conversion entre les trois religions monothéistes soient restés assez populaires jusqu’aux premières croisades du 11ème siècle, et, plus tardivement encore, entre judaïsme et islam. Enfin, l’hypothèse de missionnaires dissidents ne peut être écartée. Plusieurs sectes juives avaient – ont encore – une vision universaliste de leur religion. De ce point de vue, le christianisme n’en serait que la plus puissante expression. Le développement ultérieur de la secte caraïte en terres anciennement khazares constitue l’argument majeur de cette thèse. De fait, les Karaïm, tout particulièrement les sectateurs d’Anan ben David, menèrent, dès le 9ème siècle, d’intenses missions prosélytes auprès des peuples des trois mers : Méditerranée, Noire et Caspienne (aujourd’hui encore appelée « mer des Khazars » en de nombreux pays musulmans, notamment en Iran) ; y développant une primauté marquée de la Thora sur la tradition orale promue par les rabbins. […] »
Voyons maintenant comment évolue cette situation après les croisades :
« Les classes marchandes et guerrières de l’Europe continentale de l’Est n’ont pas participé au festin des Croisades et ni la chute de Constantinople, ni la nouvelle invasion mongole, ni l’établissement tardif des Turcs ottomans au Sud ne modifient sensiblement l’organisation commerciale et monétaire de ces régions. Les juifs en restent largement les maîtres, conservant des liens privilégiés avec les différents dominants politiques, sauf au Nord-est, où, même sous la coupe des Mongols, les orthodoxes du royaume de Novgorod s’efforcent de restreindre l’établissement des commerçants juifs. Mésopotamiens installés en Géorgie, italiens en Crimée, ceux-ci effectuent de nombreux voyages en Pologne, en utilisant les toujours actifs relais de leurs coreligionnaires khazars : Caleph Judaeus de Caffa (15ème siècle, sous domination mongole) ; David de Constantinople (16ème siècle, sous domination turque et désormais appelée Istanbul) ; commercent ainsi et régulièrement avec Lemberg.
L’absence de véritable concurrence à l’hégémonie juive va perdurer jusqu’au 18ème siècle : on a là un terrain exceptionnel d’étude du système féodal qui permet, par comparaison et analogie, de mieux entrevoir la genèse du capitalisme en Europe occidentale. On y retrouve au départ les mêmes para-mètres : confinement de l’argent entre le prince et l’usurier ; protection du second par le premier, moyennant de conséquentes taxes sur les bénéfices ; luttes entre le prince et ses grands vassaux qui sont les principaux clients des usuriers ; report des taxes royales sur les taux d’intérêt (supérieurs à 100%, en Pologne, au 14ème siècle !) prélevés par les usuriers sur cette noblesse ; exaspération des classes populaires (agriculteurs et artisans) surchargées au bas de l’échelle sociale et confinées dans une économie de survie. Sitôt que le pouvoir royal faiblit, l’influence juive décline. Mais, à la différence de l’Occident où se sont organisés des contre-pouvoirs décisifs, le système demeure longtemps en l’état, notamment en Pologne (papiste, ne l’oublions pas dans la perception de l’évolution stratégique de la Curie romaine) et se déploie sur des chemins moins courus à l’Ouest.
À l’inverse de sa consœur occidentale, la bourgeoisie juive orientale s’investit durablement dans le foncier acquis par retour de créances. L’usure des grands banquiers (Sabetaï, Iosman, Levko, à Cracovie; Miesko, Jordan, à Posen ; Fischel, Schina, à Lemberg ; etc.) parvient à amasser des biens immenses, en s’emparant très légalement de villages et de terres seigneuriales. Disposant d’atouts commerciaux conséquents pour exploiter le fruit de cette accumulation foncière, ces grands propriétaires organisent à partir de leurs fiefs citadins une véritable autonomie juive : kabal (conseil urbain) et galitoth (groupements de communautés rurales et urbaines) ; Vaad Arba Aratzoth (sorte de parlement juif international). Éparpillée dans le monde slave avec une forte concentration autour de ses anciens relais commerciaux (Crimée, Cracovie, Lemberg et Kiev, notamment), l’oligarchie khazare, renforcée par une émigration croissante, majoritairement en provenance de l’Ouest mais, aussi, du Sud-est (Mésopotamie), tend à rétablir – et même étendre – son ancien royaume, en le transposant sur le plan économique (monnaies polonaises avec caractères hébraïques, datant des 12ème et 13ème siècles).
À cet égard, la position du judaïsme lituanien est encore plus favorable que celle des juifs polonais. À l’instar de leurs coreligionnaires castillans mais beaucoup plus ouvertement et durablement (au moins jusqu’au 17ème siècle), les juifs lituaniens dominent le grand commerce, la banque, la collecte des impôts, les douanes, les mines, etc. Mais, a contrario de leurs homologues espagnols, ils portent épée et sont considérés en citoyens libres : la Lituanie a longtemps gardé des mœurs et coutumes païennes, indifférente aux considérations déicides et autres « prévenances » religieuses. L’union de Lublin avec la Pologne et, surtout, le démem-brement de cette dernière au 18ème siècle ruineront cette position privilégiée. Accompagnant la faillite du système féodal oriental, marquée – comme en Occident cinq siècles plus tôt, nous allons le voir – par des flambées de haine judéophobe, commencera alors un nouvel exode, variablement subi selon la fortune déplacée et comportant de notables exceptions : comme dans toute l’Europe, une caste de financiers de cour, normalement assez christianisée pour apaiser les esprits rageurs, subsistera contre vents et marées, assurant une continuité géographique au capitalisme juif. »
Revenons maintenant à la situation à l’Ouest…
« En Occident, la protection des princes se sera dégradée depuis bien longtemps. Dans un ensemble politique beaucoup plus instable, sous la pression de multiples intérêts concurrents de ceux des juifs, les rois et autres cités autonomes alternèrent d’abord expulsions et réintégrations, purgeant, d’une part, leurs encombrantes dettes et rétablissant, par ailleurs, de commodes intermédiaires dans la collecte des taxes. Tant que subsista le système féodal, les juifs furent toujours rappelés au service des princes, en tant qu’« esclaves du Trésor », moyennant à chaque fois de substantielles « taxes de retour » : du 12ème au 15ème siècle, quatre expulsions successives de France ; la dernière, effective au Nord de la Loire, plus variablement à son Sud, et qui ne concerne ni le Dauphiné ni la Provence, perdurant jusqu’au 17ème siècle.
Dans un premier temps, ces déstabilisations répétées ruinent les installations commerciales des juifs qui se cantonnent désormais massivement dans l’usure, le change, les pierres et les métaux précieux, concentrant le maximum de valeurs dans un minimum de volume. Dans un second temps, au fur et à mesure qu’apparaissent de nouveaux circuits monétaires et d’autant plus que le développement de ces derniers s’oppose à celui de l’usure, il va s’agir, pour des sociétés désormais dépendantes de la production de valeurs d’échange, de se débarrasser du dispositif et de l’influence des juifs qui n’ont alors de choix qu’entre l’exil et l’intégration au sein du nouvel ordre. On remarquera que cette intégration se fait « spontanément » dans l’environnement des villes en pointe des flux financiers : Venise, Gênes, Bruges à qui profite, en fin de compte, le pompage effectué par les deux premières, sensiblement amplifié par les investissements dans le commerce hanséatique de la Baltique.
Ce mouvement est d’autant plus fort que le nouveau système fonctionne sur un mode véritablement révolutionnaire. Sa base n’a pourtant rien que de très « banal » : un afflux soudain et conséquent de valeurs économiques. Après les conquêtes du khalifat de Cordoue, du royaume de Sicile et de l’empire Chrétien d’Orient, d’énormes richesses sont en effet brutalement parvenues en Occident. Malgré des troubles économiques récurrents dus à l’anarchie des mouvements monétaires, les villes connaissent un essor prodigieux. Dès la moitié du 13ème siècle, Gênes et Florence frappent les premières monnaies d’or (Venise, un peu plus tard) qui s’échangent rapidement sur tous les marchés. Si les commerçants investissent la place, en développant des foires prospères, les artisans n’en sont pas moins présents. Les uns et les autres y trouvent des financements variés, parfois usuraires mais de plus en plus intéressés à l’activité productive. Sur tous les grands marchés de Lorraine et des Flandres, comme dans les marchés secondaires (Cahors, par exemple, dans la vallée de la Garonne), on trouve de ces financiers en provenance d’Italie centrale, de Barcelone ou de Tolède, parfois regroupés au sein de guildes puissantes qui tendent à absorber un maximum d’activités en leur sein. Grands commerçants et banquiers marient leurs enfants avec ceux de leurs associés, organisant ainsi leur capital sur le moyen et long terme.
À partir de ces noyaux financiers, de grandes entreprises multinationales apparaissent (Bardi, Chigi, Médicis, Peruzzi, en Italie ; Welser, Fugger, Inhof, Hirschvögel en Allemagne ; Portinari à Bruges, etc.) qui interfèrent fortement dans le système politique, notamment par l’acquisition de grands monopoles (les Médicis et l’alun, les Fugger et l’étain : exemples célèbres et significatifs). Mais le fait d’importance est d’un autre ordre : à la différence de l’ancien système juif et, plus généralement, moyen-oriental (arabe notamment), la finance et le commerce sont désormais liées intimement à la production : première phase de la révolution moderne. Signes tangibles de cette évolution, les engins mécanisés se développent d’une manière « anormale », au regard des autres grandes civilisations de l’époque (Chine, Inde, Islam) : chaque européen possède, en moyenne, une dizaine « d’esclaves mécaniques », en particulier dans l’agriculture (charrue à roue). Sans être encore décisive, cette pré-révolution technique modèle de nouvelles façons de penser et de concevoir l’action sur le milieu environnant. Partout dans l’arrière-pays immédiat des ports (Bruges, Anvers, Venise, Gênes, Pise, Amalfi, etc.), se développent des activités industrielles (draps de Flandres, métallurgies à Milan, huiles et vins de Naples, tissus de Florence, laine anglaise…), dynamisant un tissu complexe de cités laborieuses (communes lombardes, bassin du Bas-Rhin, Wessex anglais…). La moindre rivière accueille moulins et forges, ces dernières exploitant massivement le charbon de bois tiré des forêts avoisinantes : l’Europe commence à tirer profit de ses particularités climatiques et écologiques.
C’est peut-être là, justement, l’élément décisif de l’apparent déclin, général à cette époque, des juifs occidentaux de moins en moins fixés au sol – nonobstant de notables nuances locales : au début du 14ème siècle, si ceux-ci n’assurent plus que 1 % des entrées fiscales à Paris, alors première ville européenne avec deux cent mille habitants – Cordoue a perdu en trois siècles plus de la moitié de sa population – leur part de contribution budgétaire dépasse encore les 20 % à Barcelone et même les 35 % dans le royaume de Castille. C’est aussi l’époque où la « Reconquête » chrétienne en Espagne prend une tournure nettement coercitive, preuve, s’il était besoin, de l’attachement des Espagnols à leurs religions multiséculaires (islam et judaïsme). Les procès inquisitoriaux se multiplient, plus souvent conclus par des emprisonnements et des confiscations de biens que par des exécutions et des bûchers, au demeurant toujours spectaculaires. Il faut ici bien saisir les enjeux politico-économiques. La progression chrétienne vers le Sud repose sur le système usurier féodal et la bourgeoisie juive ne cesse de s’enrichir par retour de créances. Situation cornélienne pour le pouvoir de l’Église. Alors que les princes s’opposent ailleurs à la conversion des juifs, histoire de conserver chacun son usurier-maison, l’Inquisition – présente dès le milieu du 14ème siècle dans la péninsule, elle n’y est institutionnalisée qu’au siècle suivant – réduit significativement le nombre de juifs espagnols, contribuant ainsi paradoxalement à la destruction du système féodal, un des piliers fondateurs de l’Église romaine…
Mais, bien avant que ne sévissent les moines inquisiteurs, les nouveaux convertis (les Marranes) et leurs homologues anciennement musulmans (les Morisques), connaissent de notables difficultés à intégrer la société chrétienne de leur pays. Des émigrations de populations et de capitaux s’initient dès le 13ème siècle : on part vers le Portugal, l’Aquitaine, l’Angleterre ou les Flandres ; la Navarre, la Provence, le Dauphiné, l’Italie centrale ou le Maghreb ; le bassin méditerranéen oriental ; etc. Autre paradoxe : alors que les exactions contre les juifs se multiplient en Europe occidentale, on assiste également à de massives installations en provenance du Moyen-Orient : Tolède, Lisbonne, Anvers, Livourne, Mantoue, Venise, Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Avignon, etc. On peut invoquer ici le poids de la domination mongole sur la Mésopotamie ; mais, plus sûrement, il faut lire dans tous ces mouvements celui des réalités économiques : l’Europe de l’Ouest est devenue un pôle financier d’importance eurasienne… Signe des temps : à la fin du 15ème siècle – en pleine terreur du redoutable Tamerlan – la Babylonie concentre désormais moins de 10 % de la population juive mondiale. Le capital juif – beaucoup plus fermement cadré qu’on ne le pense communément par une endogamie en passe de se généraliser dans ses communautés, surtout lorsqu’elles sont prospères – est alors en pleine phase de restructuration. Il ne réémergera officiellement dans la société occidentale que prudemment au 18ème siècle, sur des bases élargies à l’économie mondialisée du colonialisme européen, à partir surtout de leurs fiefs hollandais et anglais établis au siècle précédent. […] »
« Par ailleurs, la chute accélérée de l’empire Byzantin – moins de cinquante mille habitants à Constantinople, en 1400 (cinquante ans donc avant la prise de la ville par les Ottomans) – a initié l’exode massif de ses intellectuels et savants, surtout vers l’Italie où ils fondent, tout au long du 15ème siècle, divers lieux d’études, à l’instar de l’Académie platonicienne de Florence, sous l’égide des Médicis. Si l’arabe et l'hébreu tendent à se confiner désormais dans la sphère érudite – les travaux de traduction de l’école de Tolède touchent à leur fin – la pratique du grec et, surtout, du latin devient «Le» signe de l’homme de qualité. À la suite de Pétrarque, latiniste distingué du siècle précédent, il est maintenant bon ton d’aller chercher, après la sagesse des musulmans, celle des antiques païens, liquidant – ou croyant liquider – le tenace complexe vis-à-vis de la culture arabo-musulmane, si éblouissante depuis près de sept cents ans, si présente encore, si proche... Castiglione définit un homme universel qui embrasse tout de sa culture, en harmonie avec la Nature : l’homme est créateur et maître du Monde. Dans le climat d’opulence où baigne l’Italie de la Renaissance, Dieu est Le Beau (Marcile Ficin), bien souvent confondu avec : Dieu est Le Riche ; voire : le riche est Dieu. Le hiatus avec la pauvreté christique, éminemment populaire quant à elle et par la force des choses, est patent, approfondissant les fossés entre les classes sociales.
Tous ses courants s’affrontent et interfèrent, pénétrant la population de toutes parts, en particulier par l’intermédiaire des étudiants, répartis un peu partout en Europe (plus d’une trentaine d’universités au 15ème siècle), et, surtout, par l’apparition et le développement de l’imprimerie. Mais il convient, ici encore, de relativiser les choses. À la fin du 15ème siècle, on compte, dans toute l’Europe chrétienne, à peine cinq millions de lecteurs, très variablement lettrés, soit guère plus de 7 % de la population : encore dans leur quasi-totalité analphabètes, les peuples comprennent mal, déforment et confondent les idées en vogue, d’autant plus que l’Inquisition ne facilite guère, c’est un euphémisme, la clarté de leur exposé. Il faut ajouter à ce triste constat un autre rarement évoqué qui donne pourtant un singulier éclairage sur les politiques judéophobes de l’époque. Plus du quart de ces lecteurs sont des juifs, majoritairement en provenance des espaces musulmans. Ils étaient, là-bas, noyés dans une masse fréquemment alphabétisée, variablement cultivée certes, tout comme eux-mêmes. Mais, en se déplaçant en Europe chrétienne qui abrite maintenant, de l’Angleterre à l’Oural, plus de la moitié de la population juive mondiale, ils y émergent soudain en force culturelle de premier plan. Le déséquilibre n’est évidemment analysé, dans sa globalité, par aucun contemporain et cette lacune laisse le champ libre à toutes les interprétations abusives.
Elles le sont d’autant plus que la pensée juive est elle-même en pleine effervescence. Les siècles éclairés sous domination musulmane, solidement étayés par les travaux philosophiques de Maïmonide et, surtout, d'Éliya Delmédigo, ont profondément remué les intelligences qui s’engagent, à présent résolument, dans les nouvelles pistes de l’esprit. On les remarque dans le secteur en plein essor de l’industrie de la communication. Dès la mise au point, par Gutenberg, des caractères en plomb qui perfectionnent l’imprimerie – opérationnelle en Corée depuis au moins le 13ème siècle, faisons justice à cet énième « oubli » de l’Histoire vue de l’Occident – les juifs multiplient les lieux d’impression, notamment en Italie (Josué Salomon, Gerson ben Moïse, Joseph ben Gunzenhauzer…).
Désemparée devant l’ampleur d’un tel phénomène de société, l’Inquisition va chercher à l’étouffer par tous les moyens, notamment l’expulsion et le confinement dans les ghettos. Si la police de la pensée catholique converge en ce but avec bien des intérêts économiques antijuifs, elle rencontre également d’inattendus alliés : les autorités rabbiniques elles-mêmes. Préserver le « peuple élu » des incessantes «tentatives de corruption » du monde « goy », constitue, depuis plus de mille ans, la priorité absolue de ces rudes doctrinaires. La seule étude juste demeure celle des Talmuds (la Révélation orale) – supérieurs à la Thora (la Révélation écrite) – les écrits non religieux, éminemment suspects, et la toujours tenace indigence d’œuvres profanes juives dénotent le poids d’un tel diktat millénaire. Ainsi, il n’y aura eu, à la suite de l’œuvre de Flavius Josèphe (2ème siècle) et jusqu’au 16ème (mille quatre cents ans !), qu’un seul ouvrage d’histoire écrit par un juif (Abraham ben David, en Espagne, au 12ème siècle). Et lorsque paraîtra le premier livre d’histoire juive (le Me’or Eynayim, de ‘Azarya de Rossi, au 16ème), l’ouvrage sera immédiatement interdit par les rabbins. Toute production non-religieuse de l’esprit est susceptible de provoquer l’anathème sur son auteur, éventuellement maudit et exclu de la communauté. Il existe bien, au 15ème siècle, un consensus objectif, entre les pouvoirs dominants juif et catholique, sur la question de la culture et de la ghettoïsation, d’autant plus suivi que les menaces physiques à l’encontre des personnes sont réelles : si le ghetto isole et étouffe, il protège tout autant…
Il fait même beaucoup plus. Préservant l’identité juive, le ghetto est un des éléments fondamentaux de la restructuration du capital évoqué tantôt. En marge du fait strictement religieux, il agglomère des gens d’origines souvent diverses – conséquence des récurrentes expulsions qui leur sont imposées – autour de projets économiques locaux, insérés à l’intérieur de dynamiques internationales propulsées par des clans puissants, encore divisés, parfois opposés – notamment entre intérêts « maritimes » (Sépharades) et continentaux (Ashkénazes) – mais qui tendront peu à peu à se fédérer. Effectif réduit, dispersion géographique, mobilité vont ainsi constituer les arguments corollaires à l’identité religieuse – avant de la supplanter… – pour établir de véritables multinationales capitalistes avant l’heure. Un phénomène déjà bien avancé lors des siècles d’or de l’Islam, on y reviendra, avec la réalité des échanges de Samarcande à Cordoue et de Tombouctou à Fez, mais qui va trouver, dans la conjoncture agitée de l’expansion européenne hors de ses frontières continentales, de prodigieuses perspectives planétaires. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes que le ghetto, manifeste mesure de confinement, devînt un élément important de cet essor.
Cela prit du temps : la découverte du Nouveau Monde ne débute qu’avec le 16ème siècle, alors que les ghettos se sont généralisés dès le début du 14ème. Un siècle particulièrement obscur où l’incessante succession des épidémies – en tout premier plan, la terrible peste Noire, en provenance des comptoirs italiens de Crimée : le sous-continent y perd globalement plus du tiers de sa population ; avec des trouées locales dépassant les 75 % – et des conflits locaux de plus en plus durs, de plus en plus sauvages – Guerre de Cent ans en France, multipliant les bandes armées incontrôlées, alternant mercenariat et banditisme – inquiètent et épuisent les peuples. On ne manque alors pas de désigner à leur vindicte les plus commodes boucs émissaires, justifiant à « bon » compte de moins claires décisions politiques. Mais, pas plus ici qu’ailleurs, la cohésion sociétale ne peut se maintenir par de tels artifices. Trop d’incohérences et de tensions religieuses, économiques, sociales et intellectuelles travaillent l’Occident : elles n’attendent qu’un peu de feu aux poudres pour éclater. […] »
« Dans cet imbroglio où la concurrence économique entre les grands trusts joue déjà un rôle capital – Médicis et Fugger, là encore mais plus pour longtemps : de nouvelles stratégies émergent avec l’ouverture des océans ; guidé par un navigateur musulman, le portugais Vasco de Gama a atteint l’Inde par le Cap de Bonne-Espérance ; son compatriote Magellan, l’Indonésie par la Terre-de-Feu ; tandis que les Marranes investissent puissamment dans l’armement des navires transocéaniques – il devient rapidement évident qu’aucune réforme politique ne peut prétendre à (ré)organiser l’espace européen postféodal, étriqué à de multiples égards. […] »
« Les contradictions sociales touchent toutes les communautés. À Venise, ce sont les juifs portugais qui font chasser de leur quartier, manu militari, leurs coreligionnaires allemands ou levantins. Ailleurs, les conversions suscitent de sombres excès de zèle : sait-on, par exemple, que Salomon Halévi, l’auteur des cruelles lois anti-juives de Valladolid (14ème siècle), fut rabbin fort influent, avant de se convertir sur le tard au catholicisme ? Que le tristement célèbre Torquemada, grand-maître de l’Inquisition espagnole au siècle suivant, était le petit-fils d’une juive marrane ? Alors que nombre de grands du royaume sont eux-mêmes juifs : ainsi, sous la royauté de Ferdinand, le ministre des Finances, Isaac Abravanel qui préfèrera, lui, s’exiler plutôt que se soumettre à la complaisance d’une conversion feinte dont il n’avait eu de cesse de combattre l’arbitraire décret ; le trésorier général, Abraham Senior qui s’y plia, lui grand rabbin de sa communauté, à quatre-vingt ans passés ; et, surtout, le très puissant chancelier de la Cour, Luis de Santangel, appui majeur du très probable marrane Christophe Colomb…
Sous cette trouble rigueur inquisitoriale, apparaîtront bientôt (courant 16ème siècle), les premiers signes d’une régression « ethnique » du christianisme, prélude au racisme spécifique de l’Occident. Pour obtenir le moindre poste administratif notamment, l’Inquisition exigera un certificat de « pureté de sang » (trois générations successives d’ascendance chrétienne), récupérant étrangement – et avec quelle cruelle ironie ! – les considérations talmudiques vulgarisées par Maïmonide, quelques siècles plus tôt. Mais, avant de s’écrouler, l’Espagne, second grand État de l’ère prémoderne – après l’empire Ottoman qui est, à distance, son plus redoutable adversaire – fournit le mouvement salvateur de la Papauté. […] Reprenant le flambeau des moines-chevaliers, Ignace de Loyola, ancien militaire de carrière, déplace le champ du combat spirituel dans le domaine de l’éducation et de l’économie, en fondant au service exclusif de la Papauté la Compagnie de Jésus (dont les membres sont plus connus sous le vocable de Jésuites). L’enseignement et l’encadrement des élites sociales, par le développement de collèges ; l’endoctrinement des masses populaires, par des œuvres de vulgarisation (missel, bréviaire, etc.) ; le contrôle, plus ou moins direct, des politiques économiques des États ; deviennent enjeux de toute première importance. Par d’intelligentes manœuvres, les Jésuites se rendent maîtres de l’Inquisition – qualifiée désormais d’« Universelle » : tout un programme... – qu’ils dirigent en sous-main, selon une stratégie générale de prise de contrôle de la Curie et des organes décisionnels de la sphère catholique. De ce fait, si les nouveaux venus se montrent souvent arrangeants avec les mœurs des chrétiens aisés – la Grâce Divine est alors généreusement mise à contribution… – ils s’affrontent par contre résolument à l’élite juive dont l’influence auprès des puissants, jouant sur tous les tableaux, leur paraît un des princi-paux dissolvants de l’ordre chrétien.
À leurs yeux, celle-là n’a d’autre objectif que le rétablissement de sa puissance des temps féodaux et divise pour régner. Le conflit s’affirme avec l’éclipse des banquiers juifs à Rome, marquée par la fermeture des officines de prêt dans la ville sainte. Venise devient un des centres les plus actifs de la lutte contre l’Inquisition, sous la direction d’un puissant lobby marrane, fort de ramifications dans l’Europe entière ; tout particulièrement en Hollande où s’enracine une collaboration active entre protestants et juifs, régulièrement soutenue par un empire Ottoman alors à son apogée et conquérant en Europe de l’Est. L’exemple du richissime juif Joseph Nassi, allié du très influent clan des Mendez marranes basés aux Provinces-Unies, est à cet égard significatif. Après avoir longtemps dirigé, depuis Venise, la lutte contre l’Inquisition, il émigre en Turquie et devient ministre des Affaires étrangères du sultan ottoman Sélim II. Son réseau d’influences et d’affaires s’étend alors de Londres à Istanbul, en passant par Amsterdam, Genève, Venise ; d’Istanbul à Vienne, Cracovie, Kiev, les bords de la Baltique ; sans négliger ses anciennes relations espagnoles et portugaises – berceaux de la réussite familiale – en-deçà et au-delà des océans…
Alliance objective entre minorités opprimées, la collaboration entre protestants et juifs s’étend effectivement sur toute la planète. C’est, encore plus précisément, la négociation entre l’ambassadeur des Pays-Bas, le rabbin Menasseh ben Israël, et Cromwell, qui rétablit au milieu du 17ème siècle les juifs en Angleterre. Désormais, une entente raisonnée va lier Anglais, Hollandais et juifs, qui forment une « communauté internationale » de plusieurs singularités : peu ou prou d’espaces terrestres souverains ; des populations réduites ; un même ennemi conjoncturel : la Papauté ; des capitaux conséquents, fondés sur le commerce ou la finance. Cette entente, dont le caractère relatif s’exprime en particulier par la rivalité entre Anglais et Hollandais et la domination progressive des premiers sur les seconds, repose sur une stratégie politique visant, d’une part, à diviser les États continentaux, dans un «équilibre » de forces interdisant toute hégémonie ; d’autre part, obtenir une hégémonie décisive sur les mers et le commerce international. « Les mers britanniques », aurait dit Charles II, « ne sont limitées que par les côtes des nations ». C’est, amplifié à l’échelle planétaire, le projet méditerranéen de Venise…
Les juifs avaient accompagné et financé, en variable proportion, l’expansion portugaise et espagnole au 15ème et 16ème siècle (cf. les voyages de Colomb, probablement lui-même marrane, et de Vasco de Gama), suivant, par-là, une très vieille tradition d’essaimage marchand (association judéo-phénicienne dès l’époque du roi Salomon – PBL – soit mille ans avant J.C.). Là encore, les indiscutables compétences, en l’occurrence cartographiques, d’un Abraham Cresques, d’un Yacomo de Mallorca ou d’un Abraham Samuel Zacoto restent limitées dans leur expression publique : la vigilance des Talmudistes ne cesse de borner l’essor intellectuel des communautés juives. Soulignons en outre combien ces premières expéditions maritimes s’apparentèrent aux razzias transsahariennes des siècles précédents : les Portugais longeaient et se fixaient sur les côtes africaines avec l’idée première d’intercepter les caravanes d’or ; voire de s’en approprier les lieux d’extraction ; et à ce jeu, les intérêts juifs longtemps investis dans le commerce caravanier – de l’or mais aussi des esclaves noirs : encore une réalité soigneusement occultée de nos jours… – s’avèrent fort expérimentés. Et équipés : faute de pouvoir toujours compter sur leurs relais continentaux, fortement concurrencés par de puissants réseaux locaux non-juifs (arabo-berbères ou négro-africains), ces investissements disposaient, au 16ème siècle d’un quasi-monopole sur l’armement des bateaux transocéaniques, notamment négriers.
Le premier gouverneur portugais du Brésil est un marrane et sa communauté s’y développe puissamment, retrouvant rapidement son intégrité religieuse primitive, jusqu’à l’intervention de l’Inquisition au siècle suivant. Au Pérou, les mines d’argent du Potosi sont également sous contrôle marrane et, par le Rio de Plata (le Fleuve d’Argent), s’organise en direction du Portugal et de l’Espagne un trafic intense de métal précieux et de mercure tirés des infernales mines andines où s’anéantit une population locale réduite en esclavage : en cinquante ans, le peuple péruvien est amputé de la moitié de ses effectifs ; une « bagatelle » cependant, comparée à l’autre génocide perpétré par les Espagnols très chrétiens au Mexique : en moins de quatre-vingt ans, 96 % des autochtones y disparaissent. Les uns et les autres tentent de justifier leurs criminels agissements en invoquant le caractère « probablement non-humain » des indigènes, instruisant de très alam-biquées exégèses bibliques, parfois appuyées sur de vénérables autorités du passé (cf. Maïmonide, là encore, dont nous évoquerons un peu plus précisément les thèses dans notre troisième partie). […] »
« L’heure n’est plus à l’esclavage familial où l’intégration plus ou moins prononcée du serviteur dans le cercle des intimes donnait à la condition servile des possibilités de promotion sociale. On est déjà en plein dans l’exploitation systématisée de « l’énergie » à de strictes fins lucratives. Et quantitativement, «ça marche » : au début du 16ème siècle, les mines européennes d’argent (Andalousie, Bohême, Sardaigne, Saxe, Tyrol) débitaient quatre-vingt-cinq tonnes par an ; à la fin de ce même siècle, leur production ne dépassera pas vingt tonnes, alors que celle, officielle – il existe une fraude importante, de l’ordre probable de 20 % – en provenance des Amériques, frôlera les trois cents tonnes. Poids du sang mais on ne parle pas encore d’argent sale… Paradoxalement, ni l’Espagne ni le Portugal ne profitent de cette « manne », le déséquilibre de leur balance commerciale avec les Pays-Bas et l’Angleterre entraîne une fuite inexorable des capitaux, augmentée par les captures des corsaires anglais et hollandais, prédominants sur les océans au début du 17ème siècle. Comble d’ironie : c’est aux financiers marranes portugais (et, conséquemment, hollandais ennemis…) que l’Espagne fait appel pour sauver son économie. […] »
« Peu de ports africains ou indiens, au 16ème siècle, où ne soient installés quelques sectateurs de Moïse (PBL), certains y faisant souche ; tous liés par réseaux commerciaux : atout non-négligeable dans la négociation avec le nouveau pouvoir. L’entente s’avère rapidement payante : en moins de deux décennies, la quasi-totalité des possessions portugaises – sauf en Amérique du Sud – passe sous souveraineté anglaise ou hollandaise et les installations juives s’étendent avec la multiplication de nouveaux comptoirs en Inde orientale, Indonésie ou ailleurs. Au milieu du 18ème siècle, quatre mille juifs seront ainsi solidement installés en Amérique du Nord, tous d’origine marrane – espagnole, voire maghrébine – requalifiés Séfarades, riches et influents, en relations d’affaires internationales, notamment, nous l’avons vu, avec leurs coreligionnaires installés dans l’empire Ottoman : fondements d’une alliance judéo-anglo-saxonne qui explique, sans évidemment les justifier, bien des futurs excès judéophobes sur le sol européen… […] »
« Une seconde étape de la modernité s’est accomplie au cours de ces deux siècles de fer : le régime économique territorial au profit des rois et des grands domaines s’est imposé au régime urbain de la Renaissance. Détail non moins révélateur : officielle mais discrète, une oligarchie financière juive est de retour dans la capitale française (via le Dauphiné et la Provence) et compose le nouveau noyau – quelques centaines de personnes – du nouveau capitalisme juif dans le royaume (Samuel Bernar, banquier du roi).
En Europe de l’Est, le développement du despotisme ne ressemble à celui de l’Ouest qu’en superficie. Le régime économique territorial n’a pas en effet à s’imposer à un quelconque régime urbain : atrophiées par un système féodal dominant, nous en avons longuement parlé, les villes demeurent embryonnaires ; les manufactures et autres industries de transformation, sous-développées ; le commerce extérieur, réduit à l’exportation de matières premières, aux activités de transit et à l’importation de produits manufacturés. « Tiers-Monde » de l’époque, la Russie se développe spectaculairement d’un point de vue géographique mais tout aussi artificiellement d’un point de vue économique, grâce aux relations commerciales privilégiées qu’elle entretient principalement avec l’empire Ottoman – et les juifs sous obédience musulmane – d’une part ; l’Angleterre et la Hollande – et les juifs marranes (ou, si l’on préfère, séfarades occidentaux) – d’autre part ; le Moyen-Orient et la Chine – et les juifs sous domination mongole – enfin. Or ce développement accompagne un déclin constaté de la puissance juive dans l’ensemble de l’espace slave, signalant une faillite, singulièrement lente au demeurant, du système féodal oriental. Comment interpréter cet apparent paradoxe ? […] »
« L’aspect strictement économique [de celui-ci]] signale un divorce structurel, à l’intérieur même d’Israël (ici bien évidemment au sens d'ensemble sociétal). C’est qu’en effet le développement capitaliste, nous l’avons suffisamment explicité, est incompatible avec la survie du système féodal. Largement intégrés au nouveau système, les intérêts des Séfarades occidentaux entrèrent de fait en contradiction avec ceux des Ashkénazes. Même s’ils demeuraient le plus souvent des intermédiaires – très peu d’entre eux furent des industriels – les premiers cherchaient à attirer le plus d’argent possible pour l’immobiliser dans des investissements productifs (augmentation du capital fixe) ; les seconds, pour en tirer une plus-value immédiate en valeurs d’usage (prépondérance du capital circulant). Nuance cependant : les grands financiers ashkénazes eurent tôt fait, bien évidemment, de résoudre la contradiction en participant activement à la restructuration générale du capital juif. Dès lors, une masse monétaire croissante disparut des circuits féodaux orientaux. Mais, nouveau paradoxe, la structure économico-politique choisie par les souverains russes retarda considérablement la construction capitaliste en terres slaves. Il faut alors envisager que les bénéfices accumulés par l’usure juive d’Europe orientale et, d’une manière générale, par le système féodal réapproprié par le régime tsariste se soient investis ailleurs. Du coup, les mesures autoritaires prises par les tsars à l’encontre des juifs n’affectèrent que très lentement leur organisation, longtemps encore adaptée à la situation socio-économique de la région. Ce n’est qu’au milieu du 19ème siècle que la quasi-disparition de la Pologne et l’orientation clairement capitaliste – quoique singulièrement tardive – de la politique tsariste en enclencheront vraiment le processus de décomposition, accéléré, cela va sans dire, par un contentieux politico-social accumulé durant des siècles...
La dégradation de la position des juifs d’Europe orientale s’effectue dans un climat spirituel tendu. Tenue sous le boisseau par les Talmudistes depuis le retentissant échec de Bar Kochéba (2ème siècle) – nous y reviendrons dans la troisième partie de notre travail – une des composantes essentielles du judaïsme, le messianisme, ressurgit soudainement dans les communautés séfarades orientales, avant de s’étendre aux roumaniotes et ashkénazes, ouvrant une des plus grandes crises spirituelles dans l’histoire de cette religion. Après des études en Palestine auprès des grands kabbalistes de l’époque qui le reconnaissent comme l’Oint des temps messianiques, Sabbataï Tsevi, de la communauté de Smyrne (Turquie), soulève le délire des foules. Sa conversion à l’islam et ses pratiques religieuses déconcer-tantes alimentent les controverses au sein de toutes les communautés, jusqu’en Europe occidentale.
Quelques décennies plus tard, et à l’inverse, tant géographique (les Pays-Bas) que spirituel, le philosophe Baruch Spinoza affiche nettement son athéisme et le primat de la raison sur la foi, pro-voquant de non moins grands remous doctrinaux. Le mouvement spécifiquement juif des « Lumières » (Haskalah) naît de ces convulsions. Il sera marqué par la substitution d’une éthique messianique à la figure d’un Messie personnel. Avec l’ouverture des ghettos, la prolétarisation des masses et la dictature prochaine du scientisme, cette sécularisation des espérances judaïques marquera les temps modernes. Elle y insinue notamment la redoutable idée que les hommes peuvent désormais ; et même doivent ; transformer, voire compléter, une Création Divine « imparfaite », afin d’améliorer le Monde et la condition humaine. »
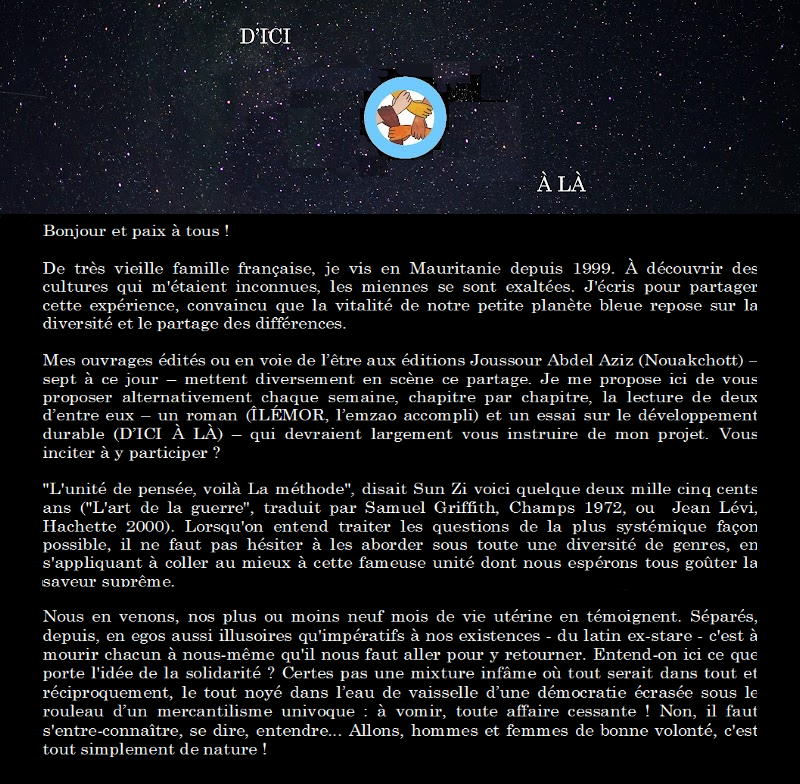

Commentaires
Enregistrer un commentaire