D’ICI À LÀ - SOMMAIRE - AVANT-PROPOS
|
|
|
|
|
|
AVANT-PROPOS |
|
7 |
|
|
PARTIE I |
MÉTHODOLOGIE |
|
|
|
|
Lutte contre la pauvreté ou avec les pauvres ? |
11 |
|
|
|
Conjoncture fluctuante, acteurs locaux fragiles |
13 |
|
|
|
Pérenniser le travail associatif |
14 |
|
|
|
Esquisses d’une stratégie en Mauritanie |
15 |
|
|
|
Complémentarités |
17 |
|
|
|
Dynamismes |
18 |
|
|
|
Bâtir sur l’acquis |
21 |
|
|
|
Civilités de l’immobile |
23 |
|
|
|
Stratégies de changement |
25 |
|
|
|
Modèles éprouvés |
26 |
|
|
|
Choix d’une méthode |
28 |
|
|
|
Quels possibles en Mauritanie ? |
30 |
|
|
|
Décès annonce de la pensée mécaniste |
33 |
|
|
|
Pensée globale : naissance ou renaissance ? |
35 |
|
|
|
Une application pratique |
36 |
|
|
PARTIE II |
ENVIRONNEMENT |
|
|
|
|
La Mauritanie : un espace vital |
41 |
|
|
|
Implication internationales |
42 |
|
|
|
Gérance pacificatrice |
44 |
|
|
|
Entre tradition et modernité |
46 |
|
|
|
Intégration systémique |
48 |
|
|
|
Un exemple typique |
50 |
|
|
|
Agriculture et biodiversité |
53 |
|
|
|
Utiles négociations |
55 |
|
|
|
L’agriculture dans la biosphère |
56 |
|
|
|
Conduites précisément ajustées |
58 |
|
|
|
Nouvelles stratégies publiques |
60 |
|
|
|
Long terme |
63 |
|
|
|
Le cas mauritanien |
64 |
|
|
|
Approche-filière du développement durable |
67 |
|
|
|
Concepts-clés |
68 |
|
|
|
Contextualisation |
70 |
|
|
|
Islam et écologie |
73 |
|
|
|
Éminence de l’éducation |
75 |
|
|
PARTIE III |
ÉDUCATION |
_ |
|
|
|
Mauritanie, quelle éducation pour nos enfants ? |
81 |
|
|
|
Alternatives tiers(trois-quarts)-mondiales |
82 |
|
|
|
Dialectique islamique en actes |
84 |
|
|
|
Perception « bionationale » |
86 |
|
|
|
Solidarités |
88 |
|
|
|
Plaidoyer pour une éducation pragmatique |
91 |
|
|
|
Répartition précise des tâches |
92 |
|
|
|
Méthodes actives |
94 |
|
|
|
Partenariat multiples |
96 |
|
|
|
Perspectives de formation professionnelle en Mauritanie |
99 |
|
|
|
État des lieux |
101 |
|
|
|
Mariages de raison |
102 |
|
|
|
Du plus concret local… |
104 |
|
|
|
… à quelle globalité ? |
106 |
|
|
PARTIE IV |
SÉCURITÉ |
|
|
|
|
Sécurité Sahel |
111 |
|
|
|
Carte blanche pour une zone de non-droit |
111 |
|
|
|
Entre compétition et entraide |
113 |
|
|
|
Militarisation de l’économie |
113 |
|
|
|
La religion, poison ou antidote ? |
115 |
|
|
|
L’insécurité, fatalité du Système ? |
116 |
|
|
|
De l’Écriture-Mère, les plus saines limites… |
119 |
|
|
|
Des sources de la violence |
119 |
|
|
|
Des remises en cause variablement en cours |
120 |
|
|
|
Une contextualisation éprouvée des textes |
120 |
|
|
|
Un trop fréquent déficit de connaissance(s) |
121 |
|
|
|
Fondamentale mesure |
122 |
|
|
|
Fidélité variable au projet de société |
122 |
|
|
|
De l’aveuglement né d’actes aveugles |
123 |
|
|
|
Voir clair et éclairer |
124 |
|
|
|
Islam mazouté |
127 |
|
|
|
Petite rétrospective contemporaine |
129 |
|
|
|
Grandes manœuvres mondiales… |
132 |
|
|
|
… sous petites combines régionales |
134 |
|
|
|
Jusqu’à quand ? |
136 |
|
|
|
D’ici à là |
139 |
|
|
|
Dialogue vital |
141 |
|
|
PARTIE V |
INTERFÉRENCES |
|
|
|
|
Leçons d’un vrai-faux débat |
145 |
|
|
|
Laïcité, quand tu nous tiens… |
147 |
|
|
|
Entre perfectibilité de l’humain et respect de la personne |
149 |
|
|
|
Une société d’athées et de croyants ? |
151 |
|
|
|
La diversité, prévention des risques |
152 |
|
|
|
Osmose |
155 |
|
|
|
La contiguïté, ciment des civilisations |
156 |
|
|
|
Déchirures |
158 |
|
|
|
Du collatéral au central |
160 |
|
|
|
Citoyenneté en islam |
163 |
|
|
|
Distinctions ou discriminations ? |
165 |
|
|
|
Côte à côte |
167 |
|
|
|
La Solidarité de Proximité, prémisse de la citoyenneté |
169 |
|
|
|
Élévation dans la cité |
170 |
|
|
|
Diversité des devoirs, diversité des droits |
172 |
|
|
|
Ordre public |
174 |
|
|
|
Débat citoyen |
175 |
|
|
|
D’une civilisation à l’autre |
177 |
|
|
|
Universalité de la proximité |
179 |
|
|
|
Une mosquée dans la ville, quoi de neuf pour la cité ? |
183 |
|
|
|
Convivialités |
184 |
|
|
|
Entre culture et nature |
187 |
|
|
|
Inversion concrète de la vie |
187 |
|
|
|
Limites et passages |
188 |
|
|
|
Fractures |
190 |
|
|
|
Approche tranquille d’une radicale métamorphose ? |
191 |
|
|
|
Une dialectique peu ou prou explorée |
192 |
|
|
|
Frontière de l’incessible et l’inaliénable |
194 |
|
|
|
Les trois pôles de l’économie planétaire |
195 |
|
|
|
Le sous-développement, laboratoire du développement durable |
196 |
|
|
|
Incessible et inaliénable, versus dynamique |
197 |
|
|
|
Un contrat social en actes |
198 |
|
|
|
Un rapport communautaire-privé gagnant-gagnant |
199 |
|
|
|
Charité bien ordonnée… |
200
|
|
|
CERISE… |
|
|
|
|
|
Bac philo 2012 |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARTES, TABLEAUX, GRAPHIQUES
|
TITRE |
DROITS |
PAGE |
|
|
Développement
conflictuel |
Auteur |
32 |
|
|
Triptyque
du développement durable |
Nojhan
in wikimedia.org |
72 |
|
|
Carte
blanche pour une zone de non-droit |
CAPRI/Thomas
Delage |
112 |
|
|
La carte
blanche retrouve des couleurs…(1) |
Auteur |
112 |
|
|
Le
verrou tchadien |
Auteur |
114 |
|
|
État du
Monde - Importance de la religion |
GALLUP
POLL |
116 |
|
|
Encadré
– La Chari’a |
Auteur |
124 |
|
|
Civilisations
antéislamiques : la charnière afro-eurasienne |
Auteur |
158 |
|
|
Conflits
et hydrocarbures |
Auteur |
160 |
|
|
Poids
des différents types d’économie en % de PIB virtuel |
Auteur |
192 |
|
|
Éléments
de comparaison du pouvoir d’achat |
Auteur |
193 |
|
|
Comparaison
France/Mauritanie coût de la vie |
Auteur |
193 |
|
|
Les
trois pôles de l’économie planétaire |
Auteur |
195 |
|
(1)
Tous les documents suivants de l’auteur sont disponibles gratuitement,
via Internet. S’adresser à l’éditeur qui transmettra.
Dépôt légal Bibliothèque nationale de Mauritanie N° : 2557-2022
AVANT-PROPOS
Le présent travail est un
recueil choisi d’un peu plus d’une décennie d’articles publiés en divers
journaux mauritaniens de langue française : « Horizons » et « La Tribune »
entre 2006 et 2009 ; « Le Calame » à partir de 2010 ; augmentés de
quelques communications internautes entamées dès 2001. Il y est surtout
question de développement durable en Mauritanie, autour de quatre grands thèmes
récurrents : gestion durable de l’environnement, éducation, sécurité et Société
civile ; avec des préoccupations apparemment plus hexagonales, pas forcément
marginales pour autant desdites récurrences, on s’en rendra bientôt compte et
qui suffiront à expliciter le titre de l’ouvrage.
Un tel ouvrage est fatalement soumis à des contraintes de répétition. Une même idée peut être ainsi présentée en différents articles. Redondances ? Il faudra plutôt y voir une diversité de perspectives propre à enrichir le propos. C’est particulièrement évident, je crois, dans notre promotion transversale d’un outil original, essentiel à notre démarche, variablement connu des sociétés musulmanes et beaucoup trop insuffisamment des professionnels internationaux du développement : le « waqf », littéralement « immobilisation », en arabe. Cet état particulier de la propriété ouvre des perspectives prodigieuses en matière de développement durable – probablement même, de transformation sociétale – susceptibles d’exploitation à l’échelle planétaire.
Ici et là, à l’occasion d’articles moins spécialisés – « Stratégies de changement », « Décès annoncé de la pensée mécaniste », « Entre culture et nature […] », par exemple – le lecteur sera convié à une réflexion plus générale qui pourrait déboucher, nous l’espérons, sur une critique personnelle de ses propres concepts. Ce n’est donc pas seulement les professionnels du développement que nous voudrions toucher. Aussi prioritaires soient-ils et quoique mon expérience en la matière ne soit guère remarquable – cela fait à peine vingt ans que je vis en Afrique et, encore, presque exclusivement en Mauritanie – elle est suffisamment décalée du point de vue dominant pour générer, incha Allah, de fructueuses et moins spécialisées remises en cause. Nous savons tous combien il est difficile de nous départir de nos schémas de pensée et plus encore lorsque ceux-ci ont été forgés durant de longues années de formation, indispensables à l’exercice de hautes responsabilités. Or certains de ces schémas et beaucoup de leurs outils d’application se révèlent aujourd’hui, non seulement obsolètes mais, pire, délétères.
Si notre planète est en danger et, avec elle, l’espèce humaine – situation qui nécessite plus que jamais de penser global – c’est toujours au plus local qu’il faut agir [1]. Le choix de m’y appliquer en Mauritanie plutôt qu’en ma patrie, la France, relève d’abord du constat de l’infiniment plus grande potentialité de la première à se départir des schémas de la pensée mécaniste. Non pas, bien évidemment, que j’aie à justifier ce choix. Mais c’est l’occasion de noter, après d’autres travaux en ce sens [2], combien le « sous-développement », du point de vue de la pensée fragmentée, peut être source, en pensée globale, non seulement de créativité mais aussi de fidélité à notre commune humanité. Ces deux faces – créativité-fidélité – ont-elles cependant commune mesure en Mauritanie ?
La question sous-tend des remises en cause – plus souvent, d’ailleurs, des relectures – spécifiques à ce pays saharo-sahélien musulman. Elles naviguent entre approfondissement et contextualisation du religieux, détachement des complexes générés par la période coloniale, compréhension affinée des fondements et contraintes du système mondialisé, le tout arbitré par cette liberté d’esprit tant caractéristique des gens du désert, si longuement démunis de tout. La toute jeunesse de son État fondé en fin des années 50 – de sa nation, même, dont le nom, « cadeau » d’adieu des colons, n’apparaît qu’à la même période – laisse pressentir des potentialités et, donc, des tensions. Elles perdureront le temps d’apporter réponse à la question susdite : négative et constatant, comme ailleurs, l’aplatissement de la singularité locale sous le rouleau compresseur de la « Société mondialisée du spectacle » ; positive et signe, alors, d’une Humanité enfin riche de toute sa diversité, où les expériences de chacun portent au meilleur de tous. Faut-il préciser qu’en cette apparente lutte du pot de terre contre le pot de fer, le temps nous est compté ?
Petite précision d’ordre technique, enfin. Si j’ai, en quelques rares occasions [3], modifié le texte initial des articles, notamment leurs notes de bas de page, pour la navigation dans l’ouvrage, je n’ai pas jugé utile d’actualiser leur propos. Il conviendra donc de bien situer chacun en son temps d’écriture, toujours signalé à l’énoncé de son titre. Bonne lecture !
Ian Mansour de Grange
Maata Moulana, Février 2020
[1] « Penser global, agir local », donc ; une expression vulgarisée par René Dubos, lors du premier Sommet sur l'Environnement en 1972. Exprimée dès 1935 par Jacques Ellul, celui-ci aura précisé, en de multiples occasions, la célèbre formule, notamment lors ses entretiens avec Madeleine Garrigou-Lagrange, A temps et à contretemps, éd. Le Centurion, 1981, p. 176-177 : « J’ai essayé, en différents ouvrages, comme La Technique ou Propagandes, de montrer ce que signifie « penser globalement » : refuser la pensée analytique, pointilliste, spécialisée. Il ne sert à rien, pour comprendre la société moderne, de prendre les phénomènes cas par cas ; par exemple : étudier [isolément] l'automobile, la télévision ou la télématique. Chacun de ces phénomènes n'a de sens que […] s'il est mis en relation avec tous les autres. Si l’on sépare, isole, un fait, on n'y comprend strictement rien. Mais inversement, pour l'action, nous avons la tendance, spontanée, à demander une action centralisée, par l'État, par un « centre de décisions » qui fait tomber les oukases « d'en haut », alors que cela ne peut aboutir à rien, les données sont trop complexes et la bureaucratie de plus en plus lourde. Dès lors, si l’on veut agir vraiment, il faut le faire à partir de la base, à échelle humaine, localement, et par une série d'actions, certes réduites en dimension mais effectuées en tenant compte de tout le donné humain. »
[2] Voir, notamment, mon ouvrage « LE WAQF, outil de développement durable ; LA MAURITANIE, fécondité d’une différence manifeste », Éditions de la Librairie 15-21, Nouakchott, 2012, réédité en 2022 par les éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott.
[3] Lorsque, par
exemple, l’application pratique de tel ou tel concept a nécessité sa révision.
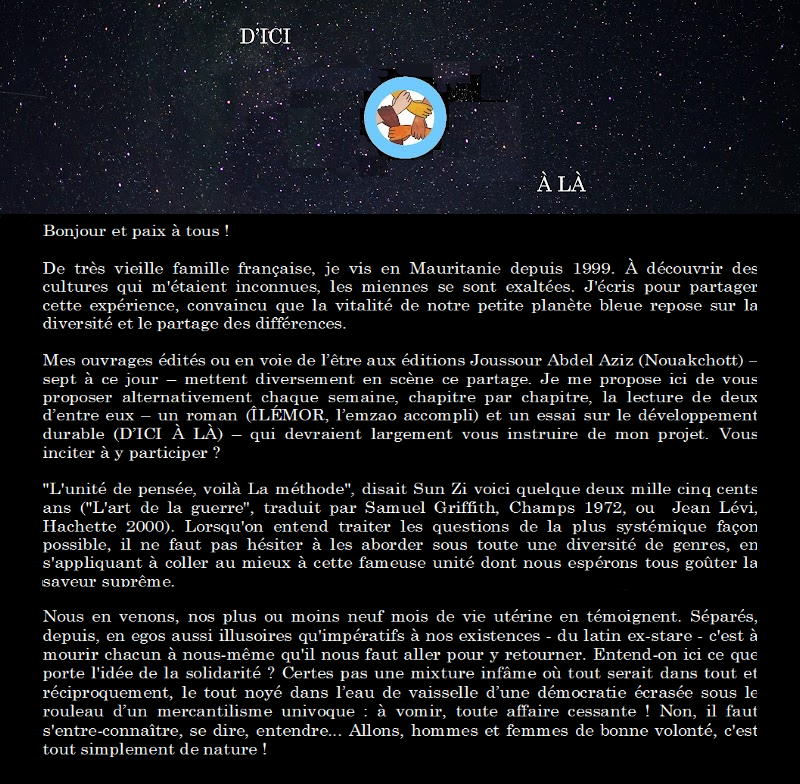


Commentaires
Enregistrer un commentaire